Une psychiatrie jugée sexiste
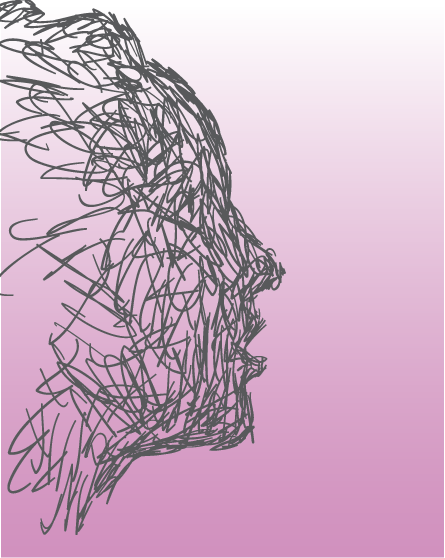
Les préjugés sexistes orientent encore les diagnostics psychiatriques que reçoivent les femmes, poussant celles-ci à consommer massivement antidépresseurs et psychotropes. Tel est du moins ce qu’avancent plusieurs observateurs du monde de la santé mentale, qui dénoncent l’existence d’une psychiatrie sexiste.
«Les diagnostics sexistes ne datent pas d’hier», lance Silvia Martinez, intervenante depuis plus de 20 ans en santé mentale au centre L’écho des femmes, dans la Petite-Patrie, à Montréal. Selon elle, une grande majorité de psychiatres posent des diagnostics plus lourds aux femmes qu’aux hommes, même pour des symptômes semblables.
L’Organisation mondiale de la santé fait état de cette situation. «Le genre féminin est un facteur qui va fortement contribuer à la prescription de psychotropes. […] Les docteurs diagnostiquent plus souvent les femmes que les hommes comme souffrant de dépression, même lorsqu’ils présentent des symptômes identiques», peut-on lire sur le site de l’Organisation.
«J’ai longtemps vu un psychiatre, et chaque fois que je lui parlais de mes angoisses, il augmentait ma dose d’antipsychotiques… J’étais devenue végétative, enfermée dans mon corps», témoigne une membre de L’écho des femmes qui a préservé l’anonymat. Avec le temps, elle a réussi à exiger un changement de spécialiste, pour ensuite faire diminuer ses doses. «J’ai l’impression d’avoir repris un peu le contrôle de ma vie», ajoute-t-elle.
«Peu de personnes osent agir de la sorte. Les femmes que nous accueillons sont très intimidées par les psychiatres», témoigne l’intervenante Manon Choinière. Cette dernière a participé, avec Mme Martinez, à la rédaction récente du Guide d’accompagnement en intervention et animation féministe en santé mentale. Dans l’ouvrage, les auteures font état d’une psychiatrie qui dépeint les femmes comme «fragiles».
«C’est une conception populaire qui persiste, cette idée que les femmes craquent plus facilement que les hommes sous la pression», observe Jean-Claude St-Onge, auteur de plusieurs ouvrages sur la santé mentale, dont Tous fous? et L’envers de la pilule. M. St-Onge estime plutôt que la majorité des femmes sont surchargées. «Non seulement elles occupent un emploi, mais ce sont surtout elles qui se consacrent aux enfants, aux tâches domestiques et au soutien des parents vieillissants», indique-t-il.
Les femmes sont aussi plus nombreuses à vivre dans la précarité, rappelle Isabelle Mimeault, chercheuse au Réseau québécois d’action pour la santé des femmes. En 2013, une Québécoise touchait un salaire moyen de 29 200$, comparativement à 39 600$ pour un Québécois, selon le Conseil du statut de la femme. Pour ce qui est des agressions sexuelles, les femmes représentent 7 victimes sur 10 parmi les mineurs, et 9 victimes sur 10 à l’âge adulte, rapporte l’Institut national de santé publique du Québec.
«Les psychiatres ont beau être professionnels, ils ont des biais, comme tous les humains. Ils sont influencés consciemment ou non par les stéréotypes ambiants, et ça a un impact sur la façon dont ils vont diagnostiquer et traiter leur patient», ajoute Geneviève Rail, directrice de l’Institut Simone de Beauvoir à l’Université Concordia.
Du côté de l’Association des médecins psychiatres du Québec, on émet beaucoup de réserves. «C’est une lecture très féminine et revendicatrice avec laquelle je ne suis pas d’accord», déclare la présidente Karine J. Igartua. Si les femmes consomment plus de médicaments psychiatriques, c’est qu’elles sont plus nombreuses à demander de l’aide. «Les hommes n’ont pas la permission sociale d’avoir des moments de faiblesse», avance-t-elle.
[pullquote]
«Est-ce que la précarité et les conditions de vie difficiles entraînent une détresse psychique? Absolument. Est-ce que ces facteurs font qu’une personne se retrouvera forcément surmédicamentée? Je crois qu’on essaye de faire des liens rapides», poursuit la psychiatre.
Il y a un manque de ressources en santé mentale qui pousse beaucoup de femmes, et d’hommes, au bord du précipice, croit la Dre Igartua. «Ça me fâche lorsque des patientes viennent me demander des pilules, alors que ce dont elles ont besoin, c’est de consulter un psychologue, mais je sais bien que ça prend parfois plus d’un an. D’ici là, leur état peut s’aggraver», déplore-t-elle. La solution réside selon elle dans une plus grande collaboration entre les psychiatres et les intervenants communautaires, afin de mieux outiller ces derniers à gérer des cas lourds de santé mentale.
Toujours plus de pilules
Au Québec, la consommation d’antidépresseurs et d’antipsychotiques a monté en flèche au cours de la dernière décennie. En 2009, 14,4% des adultes assurés par le régime public d’assurance médicaments se sont vu prescrire des antidépresseurs, comparativement à 8,1% en 1999. Parmi les quelque 350 000 nouveaux utilisateurs d’antidépresseurs, entre 2005 et 2009, plusieurs ont aussi consommé d’autres médicaments psychiatriques. L’usage d’antipsychotiques a augmenté de 10% en 4 ans. «L’utilisation des antidépresseurs est en croissance dans la plupart des pays occidentaux, en raison à la fois des campagnes de publicité par les compagnies pharmaceutiques et des préférences de certains pour la médication au détriment des psychothérapies», indique un rapport 2012 du Commissaire à la santé et au bien-être du Québec. Il y a de graves effets secondaires liés à ces médicaments, rappelle le Commissaire: une prise de poids importante pouvant mener à l’obésité, ainsi que des risques de développer du diabète, des problèmes cardiovasculaires et des troubles neurologiques, comme le parkinson.



